le corse, le basque et le breton : Comment ces langues s’intègrent-elles dans la société contemporaine ?

La richesse culturelle de la France inclut une pluralité de langues régionales, encore peu visibles dans certains espaces publics. Parmi ces langues, le corse, le basque et le breton occupent une place particulière. Ces dernières font face à des défis considérables pour éviter leur disparition. Leur survie dépend en grande partie de leur intégration dans l'éducation, les médias et la vie quotidienne sont aujourd’hui au cœur de revendications identitaires et culturelles, portées par des associations, des collectivités territoriales, des artistes ou encore des enseignants.
Éducation : l’enjeu de la transmission formelle
L’enseignement scolaire joue un rôle crucial dans la transmission et la revitalisation des langues régionales.
Le Pays basque bénéficie d’un système éducatif bien structuré pour la langue basque, notamment grâce aux ikastolas (écoles immersives privées). À cela s’ajoute l’enseignement bilingue dans le public et le privé sous contrat. En 2018, 67 % des écoles primaires de la région proposaient un enseignement bilingue ou immersif, contre 42 % en 2004 et le nombre d’élèves scolarisés en bilingue a progressé de 79 % en 14 ans, atteignant plus de 10 600 élèves, selon la Banque des territoires.
Le réseau Diwan, créé en 1977, propose un enseignement immersif en breton. En parallèle, les écoles publiques et catholiques ont intégré des filières bilingues. À la rentrée 2024, plus de 20 000 élèves étaient scolarisés dans les trois filières bilingues de Bretagne selon Breizh-Info. Toutefois, ce chiffre reste modeste en comparaison de la population globale : seuls 2 % des enfants bretons suivent une scolarité immersive selon l’Invitu, ce qui limite son ancrage durable.
En Corse, la langue est enseignée de manière obligatoire depuis la maternelle, à raison de trois heures par semaine en primaire comme l’est indiqué sur le site internet de l’Académie de Corse. Pourtant, malgré cette obligation, peu d’élèves atteignent une maîtrise réelle du corse, en effet, seulement 14 % des parents ont appris le corse à leurs enfants selon Corse Net Info, indiquant une transmission familiale en déclin. Le manque de filières immersives ou de véritables cursus bilingues constitue un frein majeur. L’Assemblée de Corse a néanmoins lancé une expérimentation de classes immersives en 2022 (comme indiqué dans le Rapport numéro 2022/02/275 de l’Assemblée de Corse), mais celle-ci reste encore marginale.
Médias : entre visibilité et accessibilité
Les médias sont un vecteur essentiel pour faire vivre une langue hors du cadre scolaire. Ils permettent une exposition régulière, touchent un public large et jouent un rôle fondamental dans la normalisation linguistique.
La langue basque bénéficie d’un soutien médiatique important, notamment grâce à la chaîne EITB (Euskal Irrati Telebista), qui propose des contenus télévisés et radiophoniques en basque. Des journaux, des radios communautaires et des plateformes en ligne contribuent aussi à sa diffusion, une dynamique médiatique qui par conséquent participe à la vitalité de la langue.
Le paysage médiatique breton reste plus fragile. Radio Kerne, Arvorig FM ou encore Brezhoweb proposent des contenus entièrement en breton. Cette dernière mise sur les réseaux sociaux pour capter un public jeune, avec certaines vidéos atteignant plus de 20 000 vues sur YouTube. France 3 Bretagne diffuse également quelques émissions hebdomadaires en breton. Toutefois, l’offre reste limitée, et souvent relayée à des horaires peu visibles.
En Corse, certaines chaînes proposent des émissions, des journaux télévisés et des documentaires en langue corse. Cette présence audiovisuelle a renforcé l’usage du corse dans l’espace public. La radio RCFM, ainsi que plusieurs artistes de la scène musicale insulaire, participent également à la vitalité linguistique. Une enquête menée par Corse Net Info de 2013 indique que 93 % des Corses écoutent régulièrement de la musique en langue corse, ce qui en fait un vecteur culturel puissant.
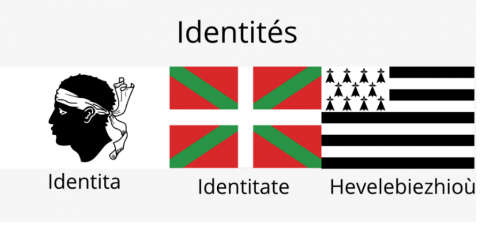
Vie quotidienne : la réalité de l’usage
Le véritable enjeu reste l’usage de la langue dans la vie quotidienne, au-delà du cadre scolaire ou médiatique. Cela passe par la transmission familiale, l’usage dans les commerces, les services publics ou les interactions sociales.
Environ 31 % de la population du Pays basque français déclare comprendre ou parler le basque, soit environ 50 000 personnes. Toutefois, cette proportion chute fortement chez les plus jeunes : seuls 14 % des 16-24 ans sont bilingues, contre 36 % chez les plus de 65 ans comme indique le Rapport numéro 4238 de l’Assemblée nationale fait « Au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation sur la proposition de loi relative à la promotion des langues régionales ». Le basque reste donc une langue majoritairement apprise en milieu scolaire, mais rarement transmise en famille ou utilisée quotidiennement.
La situation du breton est encore plus critique. Sur les quelque 200 000 locuteurs bretons recensés en 2018, soit 5,5 % de la population bretonne, 79 % ont plus de 60 ans selon un article de l’INA. Le breton est rarement utilisé dans la sphère privée ou publique, même chez les personnes qui le parlent. La majorité des enfants apprenant le breton à l’école ne l’utilisent pas en dehors du cadre scolaire, ce qui compromet la transmission intergénérationnelle.
Le corse est encore largement compris : environ 100 000 personnes, soit près de 45 % de la population adulte de l’île, déclarent le comprendre, et 70 000 le parlent régulièrement comme l’indique le Rapport de l’Assemblée nationale. Cependant, seuls 10 % des Corses disent l’utiliser exclusivement en famille selon Corse Net Info. La langue reste cantonnée à des contextes culturels ou identitaires, et son usage réside dans la sphère familiale.
Si le corse, le basque et le breton témoignent d’un riche patrimoine linguistique, leur survie dépend aujourd’hui d’un équilibre complexe entre efforts institutionnels et pratiques sociales. L’école et les médias ont permis d’enrayer leur disparition à court terme, mais ces langues ne seront réellement sauvées que si elles retrouvent leur place dans la vie quotidienne. La clé réside sans doute dans une approche plus globale.
Julen Auz-Gaffori



