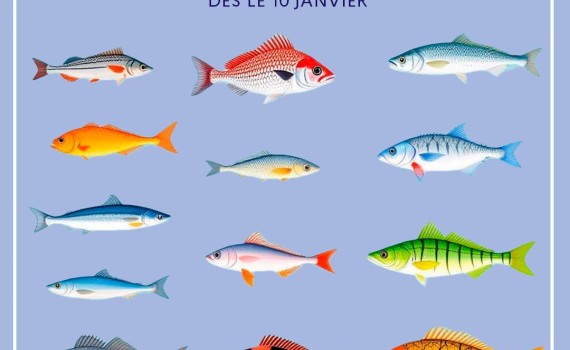Paoli et le Royaume Anglo-Corse : Comment la Corse est devenue une île britannique (pendant deux ans).

Contexte et formation du Royaume anglo-corse
Nommé lieutenant général de la nation corse et commandant de la Garde nationale, il porta un projet d’autonomie inspiré des idéaux révolutionnaires tout en maintenant le catholicisme comme religion d’État.
Pourtant, la radicalisation jacobine et la centralisation du pouvoir le conduisirent à rompre avec la Convention nationale en 1793, l’amenant à solliciter l’appui de la Grande-Bretagne et à jeter les bases du Royaume anglo-corse, car les autorités britanniques, en quête d’un repli après leur retrait de Toulon, virent dans la Corse un point d’ancrage stratégique en Méditerranée.
Conquête militaire et prise de contrôle
Au début de 1794, l’amiral Samuel Hood envoya une escadre en Corse pour assiéger les positions françaises, sur la foi des assurances de Paoli quant aux faibles effectifs ennemis.
Les Britanniques, appuyés par des irréguliers corses, prirent San Fiurenzu par bombardement et débarquements amphibies, puis prirent Bastia après un siège de six semaines.
À l’été 1794, la chute de Calvi scella la victoire anglo-corse : le blocus naval et le siège de 52 jours obligèrent la résistance française à capituler, ouvrant la voie à la proclamation du royaume.
Constitution et gouvernance
Le 19 juin 1794, la Consulta générale de Corte proclama l’indépendance de la Corse et adopta une constitution fixant une monarchie constitutionnelle sous George III. Rédigée en italien par Carlo Andrea Pozzo di Borgo et Bonfiglio Guelfucci, la Constitution garantissait un Parlement bicaméral, un suffrage censitaire et une liberté de la presse.
Le vice-roi britannique, Sir Gilbert Elliot, fut nommé représentant du roi sur l’île, assisté d’un Conseil d’État présidé par Pozzo di Borgo, devenu véritable chef du gouvernement local.
Dissolution et héritage
Le Royaume anglo-corse, officiellement reconnu comme État client de la Grande-Bretagne, survécut seulement de 1794 à 1796 durant les guerres révolutionnaires françaises.
En octobre 1796, face à l'avancée des troupes françaises et à l’érosion du soutien populaire, le régime fut abrogé et les Britanniques évacuèrent l’île.
La Corse retrouva rapidement son statut de département français après la paix de 1796, mais l’expérience constitua l’une des premières tentatives d’adaptation du modèle politique britannique hors de Grande-Bretagne. La France se verra ensuite gouvernée par Napoléon 1er, originellement général dans les armées de la 1ère République, dès le 18 mai 1804.
Nouvel Espoir
Une décennie plus tard, le printemps 1814 signe le début de la fin pour l’Empire de Napoléon Ier face aux puissances coalisées, entraînant sa première abdication et son exil à l’île d’Elbe, à la suite du traité de Fontainebleau signé à Paris le 11 avril 1814. La vacance du pouvoir impérial permit aux Britanniques de consolider leur présence en Méditerranée, notamment après la prise de Gênes par Lord William Bentinck en avril 1814 lors du siège de la ville.
La Corse restait une position stratégique idéale pour contrôler les routes maritimes entre la France et l’Italie, amenant donc la possibilité d’une nouvelle alliance.
Le Traité de Bastia
À la fin du mois d’avril 1814, des assemblées de notables corses se réunirent à Bastia, Saint-Florent et L’Île-Rousse, invitant Bentinck à intervenir pour chasser les forces impériales françaises.
En réponse, Lord Bentinck dépêcha des troupes qui assurèrent l’évacuation des garnisons françaises et signa ensuite, entre début et mi-mai 1814, le traité de Bastia, octroyant la souveraineté de l’île à la couronne britannique tout en garantissant un large gouvernement local autonome.
Lord William Bentinck, célèbre pour ses ambitions en Italie, voyait dans ce traité un levier pour promouvoir l’unité italienne et renforcer la position britannique dans le bassin méditerranéen.
Les notables corses, eux, sont marqués par le désir d’autonomie et la défiance envers l’administration impériale française, et espéraient trouver dans la Grande-Bretagne un partenaire garantissant leurs privilèges locaux.
La Corse, située à seulement 50 km de l’île d’Elbe et à mi-chemin entre la France et l’Italie, offrait un point d’ancrage naval stratégique pour la Royal Navy.
Rejet et retour définitif à la France
Toutefois, Robert Stewart (aussi connu sous le nom de Lord Castlereagh), secrétaire d’État aux Affaires étrangères, repoussa tout renouveau du Royaume anglo-corse, rappelant que Louis XVIII avait été reconnu souverain de l’ensemble des anciens territoires français.
La cour d’appel d’Ajaccio déclara également la convention illégale, dénonçant un acte pris sans mandat explicite de la population insulaire.
Dans les semaines qui suivirent, Londres ordonna l’évacuation des troupes britanniques, et la Corse fut réintégrée dans le giron français lors du traité de Paris de mai 1814.
Bien que l’île ne soit jamais restée sous domination britannique, cet épisode illustre les jeux d’influence européens et les aspirations autonomistes corses à la veille de la Restauration, ainsi que la volonté du Babbu di a Patria de continuer son combat pour une Corse libre.
Anthony Muraccioli